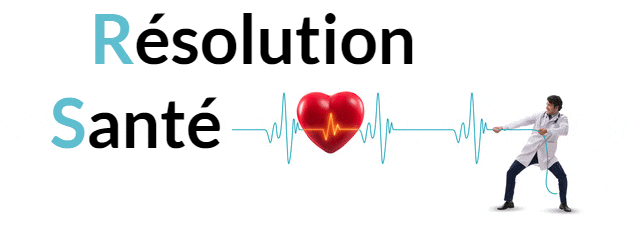Grâce à la contraception et à la disponibilité généralisée des techniques de reproduction, les couples ont aujourd’hui plus de contrôle sur le moment où ils veulent fonder une famille que par le passé. Il est possible d’attendre pour fonder une famille, mais cela peut rendre la grossesse un peu plus difficile.
La fertilité diminue naturellement avec l’âge, et le fait d’avoir un bébé plus tard dans la vie peut augmenter le risque de complications pendant la grossesse. Cela dit, il n’y a pas de meilleur âge pour tomber enceinte. La décision de fonder une famille devrait être fondée sur de nombreux facteurs – y compris votre âge et votre volonté d’être parent. Le fait que vous ayez plus de 30 ou 40 ans ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir un bébé en bonne santé.
Lire la suite pour en savoir plus sur la grossesse à chaque étape de votre vie.
Dans la vingtaine
Les femmes sont les plus fertiles et ont les meilleures chances de tomber enceintes dans la vingtaine. C’est le moment où vous avez le plus grand nombre d’ovules de bonne qualité disponible et où vos risques de grossesse sont les plus fort. À 25 ans, vos chances de concevoir après 3 mois d’essai sont d’un peu moins de 20 %.
Dans la trentaine
La fertilité commence à diminuer graduellement vers l’âge de 32 ans. Après l’âge de 35 ans, ce déclin s’accélère. Les femmes naissent avec tous les œufs qu’elles auront – environ 1 million. Le nombre d’œufs diminue progressivement au fil du temps.
À 37 ans, on estime qu’il vous restera environ 25 000 œufs. L’âge de 35 ans, vos chances de concevoir après 3 mois d’essai sont d’environ 12 pour cent.
Le risque de fausse couche et d’anomalies génétiques commence également à augmenter après 35 ans. Vous pourriez faire face à plus de complications au cours de votre grossesse ou de l’accouchement si vous avez un bébé plus tard dans votre vie.
C’est pourquoi votre médecin pourrait vous recommander d’autres tests de dépistage et de dépistage pour vous et votre bébé.
Dans la quarantaine
Il y a une forte diminution de la capacité d’une femme à tomber enceinte naturellement dans la quarantaine. À 40 ans, vos chances de concevoir après 3 mois d’essai sont d’environ 7 pour cent.
Avec le temps, la quantité et la qualité de vos œufs diminuent. Les œufs plus âgés peuvent avoir plus de problèmes chromosomiques, ce qui augmente les chances d’avoir un bébé atteint d’une anomalie congénitale.
La plupart des femmes dans la quarantaine peuvent encore avoir une grossesse et un bébé en santé, mais les risques augmentent considérablement pendant cette période. Ces risques sont les suivants :
- Accouchement par césarienne
- Naissance avant terme
- Faible poids à la naissance
- Malformations congénitales
- Mort post-natal
Les conditions médicales, comme le diabète et l’hypertension artérielle, sont plus fréquentes chez les femmes de plus de 35 ans. Ceux-ci peuvent entraîner des complications de la grossesse comme le diabète gestationnel et la pré-éclampsie.
Après l’âge de 40 ans, votre médecin peut effectuer des tests et une surveillance supplémentaires pour déceler d’éventuelles complications.
Options de fertilité
Si vous avez plus de 35 ans et que vous essayez de tomber enceinte depuis plus de 6 mois, vous avez peut-être des problèmes de fertilité. Votre médecin ou un spécialiste de la fertilité peut vous aider à déterminer pourquoi vous n’êtes pas encore enceinte et vous recommander les prochaines étapes pour essayer de concevoir.
Les techniques de procréation assistée (TPA) peuvent vous aider à concevoir, mais elles ne peuvent pas compenser entièrement la baisse de votre fertilité liée à l’âge.
Les médecins traitent les problèmes de fertilité chez les femmes avec des médicaments qui stimulent la production d’ovules et des techniques comme la fécondation in vitro (FIV). Mais les chances de réussir une grossesse avec ces méthodes diminuent à mesure que l’on vieillit.
Une autre option est d’utiliser un ovule donneur en bonne santé. L’ovule est fécondé avec le spermatozoïde de votre partenaire, puis transféré dans votre utérus.
Congélation des œufs
Si vous n’êtes pas tout à fait prêt à fonder une famille, mais que vous savez que vous en voudrez une à l’avenir, vous voudrez peut-être songer à congeler vos œufs pendant vos années de reproduction maximale.
D’abord, vous prendrez des hormones pour stimuler la production d’œufs. Ensuite, les œufs seront récupérés et congelés. Ils peuvent rester congelés pendant plusieurs années.
Lorsque vous êtes prêt aux utiliser, les ovules seront décongelés et injectés avec un spermatozoïde pour être fécondés. Les embryons résultants seront ensuite implantés dans votre utérus.
Congeler vos ovules ne garantit pas une grossesse. Concevoir – même avec des œufs plus jeunes – est plus difficile une fois que vous êtes dans la fin de la trentaine et la quarantaine. Mais elle peut vous assurer que des œufs sains sont disponibles lorsque vous êtes prêt.
Fertilité masculine
La fertilité d’un homme diminue également avec l’âge. Mais ce processus se produit plus tard, généralement vers l’âge de 40 ans.
Après cet âge, les hommes ont un volume de sperme et un nombre de spermatozoïdes inférieurs. Le sperme qu’ils ont ne nage pas aussi bien.
Les spermatozoïdes d’un homme âgé sont également plus susceptibles de présenter des anomalies génétiques que ceux d’un homme plus jeune.
Plus un homme est âgé, plus il lui faudra de temps pour mettre son partenaire enceinte. Et son partenaire est plus à risque de faire une fausse couche, quel que soit son âge.
Cela ne veut pas dire qu’un homme ne peut pas avoir d’enfants dans la quarantaine et au-delà. Mais cela pourrait être un peu plus difficile qu’il ne l’était plus tôt dans sa vie.
Avantages d’avoir des enfants plus tard
En plus de vous donner le temps d’explorer votre carrière et votre relation, l’attente d’une grossesse présente d’autres avantages pour vous et votre bébé.
Une étude de 2016 a révélé que les mères plus âgées sont plus patientes et ont tendance à crier et à punir leurs enfants moins souvent. Leurs enfants ont également moins de problèmes sociaux, émotionnels et comportementaux à l’école primaire.
La recherche a également montré que les enfants nés de mères plus âgées sont généralement en meilleure santé et finissent plus instruits que leurs pairs nés de mères plus jeunes.
Attendre d’être enceinte pourrait même vous aider à vivre plus longtemps. Une autre étude réalisée en 2016 a révélé que les chances de vivre jusqu’à 90 ans étaient beaucoup plus élevées chez les femmes qui ont retardé la procréation.
Il n’y a aucune preuve que le fait de retarder la procréation cause directement l’un ou l’autre de ces effets. Il est possible que d’autres facteurs chez les mères plus âgées que leur âge aient pu jouer un rôle. Mais ces résultats suggèrent qu’il y a certains avantages à attendre.
Quand obtenir de l’aide
Si vous avez essayé de tomber enceinte, mais que vous n’avez pas eu de chance, il est temps de consulter un spécialiste de la fertilité.
Voici quand consulter un médecin :
- Dans l’année qui suit l’essai si vous avez moins de 35 ans et dans les 6 mois si vous avez plus de 35 ans
- Les couples avec des maladies génétiques connues ou ceux qui ont fait plusieurs fausses couches devraient également consulter leur médecin ou un spécialiste de la fertilité.
A emporter
Les années qui passent peuvent rendre la grossesse plus difficile. Pourtant, il est toujours possible d’avoir un bébé en bonne santé lorsque vous avez la trentaine ou la quarantaine.
En fin de compte, le moment idéal pour tomber enceinte, c’est quand vous vous sentez bien. Il n’est pas déraisonnable d’attendre d’avoir plus confiance en votre carrière et en vos finances pour commencer à bâtir votre famille.
Si vous choisissez d’attendre, vous voudrez peut-être consulter votre médecin ou un spécialiste de la fertilité pour vous assurer qu’aucun problème de santé ne vous empêchera d’y arriver une fois que vous serez prêt.
Optimiser ses chances : bilan préconceptionnel et accompagnement holistique
Au‑delà des statistiques liées à l’âge, il est utile de penser à une préparation préconceptionnelle personnalisée qui évalue la réserve ovarienne (par exemple via le dosage de l’AMH), la présence d’endométriose ou d’un syndrome des ovaires polykystiques, ainsi que la qualité de la spermatogenèse du partenaire. Un bilan complet peut comprendre une échographie pelvienne, une évaluation andrologique et des tests ciblés (y compris le dépistage de la fragmentation de l’ADN spermatique lorsque cela est pertinent). La consultation génétique peut aussi être proposée lorsqu’il existe un antécédent familial ou des anomalies détectées au dépistage prénatal, afin de définir une stratégie médicale et un suivi adapté.
Parallèlement aux examens médicaux, l’optimisation du mode de vie joue un rôle clé : contrôle de l’indice de masse corporelle (IMC), équilibre nutritionnel (apport en folates, vitamine D et oméga‑3), arrêt du tabac et limitation de l’alcool, gestion du stress et exposition réduite aux perturbateurs endocriniens. L’accompagnement pluridisciplinaire — incluant nutritionniste, psychologue et spécialiste en reproduction — favorise une prise en charge globale et augmente les chances de réussite d’un projet parental. Pour des ressources et un soutien complémentaire sur la préparation à la parentalité et les parcours de soin, vous pouvez consulter Soin Et Compassion qui propose des informations pratiques et des pistes d’accompagnement adaptées aux besoins du couple.
Préparer aussi le terrain administratif, professionnel et émotionnel
Au-delà des bilans médicaux et des protocoles de prise en charge, il est essentiel d’anticiper les dimensions non cliniques d’un projet parental. Penser à la planification financière (épargne, coût des soins, couverture mutuelle) et aux droits liés au travail (congé parental, aménagement d’horaires, politique de télétravail) permet de réduire le stress et d’optimiser les chances de réussite du projet. Sur le plan scientifique, des approches émergentes comme l’étude du microbiome, épigénétique, chronobiologie apportent des pistes complémentaires à la simple exploration hormonale : elles interrogent l’impact des rythmes circadiens, de l’exposition environnementale et des marqueurs épigénétiques sur la qualité reproductive et le développement embryonnaire. S’informer sur ces notions peut aider à orienter des choix de vie pertinents sans pour autant remplacer les recommandations médicales classiques.
Concrètement, établissez une check‑list regroupant documents médicaux, historique familial, garanties d’assurance et contacts professionnels pour faciliter les démarches (congé, aménagement). N’hésitez pas à solliciter un accompagnement psychosocial ou un conseiller en périnatalité pour travailler la gestion du stress, la communication de couple et la préparation mentale à l’éventualité d’un parcours long ou complexe. Une préparation globale, qui combine aspects administratifs, soutien psychologique et ouverture aux nouvelles approches scientifiques, complète la démarche médicale et contribue à un projet parental mieux structuré et plus serein.
Approches environnementales et interventions complémentaires à considérer
Au‑delà des bilans hormonaux et des techniques de reproduction, il est pertinent de porter une attention renforcée aux déterminants environnementaux et aux processus biologiques souvent méconnus qui influencent la fertilité. L’exposition chronique à des polluants (pesticides, métaux lourds, solvants domestiques), la qualité de l’air intérieur et l’alimentation peuvent agir via des mécanismes d’oxydation, d’altération épigénétique et de perturbation du métabolisme cellulaire. La mesure de biomarqueurs (marqueurs inflammatoires, stress oxydatif, profils métalliques) et la mise en place de stratégies ciblées — réduction des sources d’exposition, choix d’alternatives alimentaires à faible charge chimique, ventilation des espaces de vie — contribuent à préserver la gamétogenèse et la compétence embryonnaire. Sur le plan nutritionnel, favoriser des aliments riches en polyphénols, en antioxydants naturels et en acides gras essentiels, tout en limitant l’apport en contaminants, est une composante complémentaire utile aux recommandations médicales.
En parallèle, des interventions non pharmacologiques encadrées peuvent améliorer la résilience du couple face aux traitements et aux parcours de fertilité : programmes d’activité physique régulière et adaptée, optimisation de la qualité du sommeil, techniques de gestion du stress (méditation, biofeedback, thérapies brèves) et prise en charge périnéale par un kinésithérapeute. Certaines démarches complémentaires comme l’acupuncture ou des protocoles de soutien nutritionnel peuvent être explorées en coordination avec l’équipe médicale pour renforcer le bien‑être et la tolérance aux procédures. Il est important que ces approches soient intégrées dans un plan personnalisé, fondé sur des bilans biologiques et une évaluation des expositions, afin d’éviter les interactions indésirables et de maximiser l’efficacité globale.